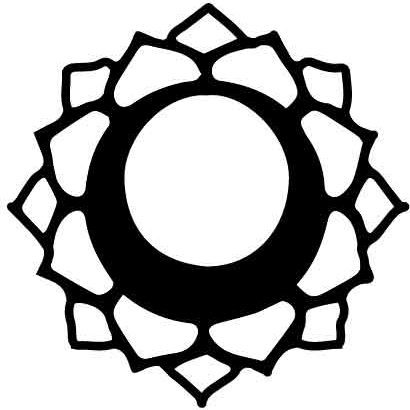Dans son style toujours aussi métaphorique et brillant, Richard Powers dépeint le parcours de neuf personnages dont les destins vont se lier autour d’un combat essentiel de la cause environnementale.
Par Olivier Lamm (Critique littéraire de Libération)
«Dans le jardin, tout autour de la maison, les créatures qu'ils ont plantées créent du sens, créent l'important, aussi aisément qu'elles produisent du sucre et du bois à partir de rien, de l'air, du soleil et de la pluie. Mais les humains sont sourds.» C'est l'histoire d'une prise de conscience, dont ceux qui ont fait l'expérience ont vu leur existence déviée brutalement de sa marche et s'interrogent chaque jour sur les raisons qui font que la majorité de l'humanité ait pu y échapper. Un récit d'arbres et d'humanité, qui aurait eu la fâcheuse tendance à faire ricaner la plupart des curieux qui demandaient à Richard Powers le sujet de son prochain roman ces cinq dernières années. «Un roman sur les arbres ? Vraiment ?» Sans doute ceux-là n'avaient pas eu vent du succès de la Vie secrète des arbres, best-seller mondial de l'ingénieur forestier allemand Peter Wohlleben. Pour le lecteur qui découvre l'Arbre-monde en cette rentrée 2018, le douzième roman de l'Américain s'inscrit en tout cas dans une tendance sensible au sein du monde des idées contemporain, portée par autant d'anthropologues (Eduardo Kohn) que de sociologues (Bruno Latour) et de scientifiques (Ernst Zürcher) tous devenus, par la force des choses, militants : le domaine des arbres est parmi les plus méconnus du vivant, et l'homme ne se sauvera pas sans se préoccuper de ses forêts. Epidémie. Powers, qui a largement consacré sa prose précise et lyrique aux arcanes de la vie sous toutes ses formes dans Orfeo ou The Gold Bug Variations (son grand roman de 1991, inédit en français), n'avait mystérieusement jamais consacré de livre à la cause environnementale et à ceux qui la défendent. Investi de sa propre épiphanie, l'Arbre-monde est en quelque sorte le roman de sa conversion, au moins autant qu'une oraison pour sa nouvelle passion : voilà un tiers de siècle qu'il use de la littérature la plus pure pour transmettre les idées les plus complexes sur l'art, l'hérédité, la technologie, l'esprit et l'humain et, à son niveau d'écrivain, changer le monde un lecteur à la fois. A l'image de cette définition du livre idéal défendu par le plus écrivain des personnages de ce nouveau roman : «Un impossible triplé [combinant] optimisme, utilité et vérité.» Choral et audacieusement construit en quatre parties hautement métaphoriques («racines», «tronc», «cime» et «graines»), le récit entreprend d'évoquer les destins lâchement liés de neuf protagonistes et des circonstances qui ont mené chacun à l'action. La première partie, très dense, se dissémine en neuf longues nouvelles dont chacune aurait pu aboutir à un roman en soi, vertigineux de détails et de conséquences : celui de Nicholas, artiste dépressif dont la famille, avant de disparaître brutalement, avait réussi à maintenir en vie l'un des derniers châtaigniers d'Amérique, espèce éradiquée au début du XXe siècle suite à une épidémie cryptogamique ; celui de Neelay, fils d'immigrants indiens devenu paraplégique suite à la chute d'un arbre, qui devient un génie des jeux vidéo et l'auteur d'un jeu inspiré par le débordement du vivant ; ceux encore de Douglas, vétéran de guerre et de l'expérience de Stanford, d'Olivia, étudiante revenue d'entre les morts qui pense communiquer directement avec la nature, ou de Patricia, sourde, garde-forestière et dendrologiste, auteure d'une thèse révolutionnaire sur la manière dont les végétaux communiquent. Tous ceux-là (et quelques autres) se retrouveront autour d'actions inspirées par le «Redwood Summer» de 1990, événement central des «Timber Wars» qui virent s'opposer éco-guerriers et exploitants forestiers d'Amérique du Nord à un moment charnière de la transformation de la sylviculture en exploitation intensive, cette «économie suicidaire». Avec eux, Powers s'instruit, donc, et nous enseigne en même temps une leçon qui tient autant de la science que de la philosophie : comment la nature pense, se parle à elle-même et s'organise sans avoir recours à la raison ; comment les forêts s'organisent par le biais de vastes réseaux de communication ; comment les arbres «imaginent» leur propre destin quand ils font s'étendre leurs branches vers le ciel et le futur. Défiance. Opérant d'incessants va-et-vient entre ses personnages et la nature qu'ils observent, l'Américain s'émerveille et se fascine, encore et encore, et écrit, des manifestes pour le vivant tel qu'il n'en finit plus de féconder des prodiges à l'insu du regard de l'humanité, et quelques-unes des plus luxuriantes phrases qu'il ait jamais rédigées (ce qui, pour ceux qui l'admirent, en dit long sur leur intensité). A cet égard, on se dit souvent que la rencontre de ce grand écrivain du réseau et de l'attention avec l'interconnexion au cœur de la nature végétale tenait de l'évidence. A l'instar de l'Américaine Lydia Millet, Powers aurait pu se passionner pour la cause des animaux, mais l'arbre était sans doute plus discret, et mieux adapté à son art de la métaphore. Car l'Américain parle encore et toujours de littérature, et à de nombreux égards cette fable sur la découverte du monde sous le monde (le titre original, The Overstory, était intraduisible en soi mais idéalement choisi) réfléchit autant à son langage et à notre soif d'histoires qu'à la catastrophe qu'il décrit. Pour la première fois, pourtant, il oppose une défiance au génie humain et à la littérature qui serait l'une de ses plus essentielles créations. Puisque la vie ne doit rien à la raison, «le sens lui-même est une chose bien trop jeune pour l'influencer» - et le langage lui-même n'est pas loin d'être réduit à une trivialité face aux arbres éternels, ordinateurs avant l'heure, livres entrouverts, multiplicités irréductibles. Sans adopter la misanthropie profonde de ses personnages, l'Arbre-monde n'a de cesse de présenter l'humain comme «le plus problématique des grands mammifères», qui pense tout de travers y compris les moyens de sa propre survie. Il constitue ainsi le premier des romans de cet humaniste à exclure l'homme de son combat, ou tout du moins à considérer le paradoxe qu'il y a à faire littérature d'un monde qui ne souffrirait sans doute pas qu'il ne soit plus là.